Le mythe du bon sauvage
Dès la bande annonce, cette voix off ambiance gossip girl à la plage avait de quoi agacer, mais ce film passait au Max Linder et je vois tous les films que passe le Max Linder. Ce film, c’est Savages. Evacuons déjà ce premier point : la voix off. Pendant deux heures, la voix off d’une fille qui ne sait pas jouer et qui croit qu’on est tellement bête qu’il faut tout nous expliquer jusqu’à la défintion de « sauvage », non, ce n’est pas possible. Mais la voix off d’une fille qui ne sait pas jouer et qui nous fait croire qu’elle meurt à la fin, alors que ce n’est pas vrai, c’est encore pire. C’est de la publicité mensongère. On tient uniquement parce qu’on attend le moment béni où elle va mourir à la Marion Cotillard. Sur ce point, donc, Oliver Stone est bien cruel de nous faire croire qu’on aura ce plaisir. Mais c’est uniquement sur ce point qu’Oliver Stone retrouve sa cruauté d’antan.
A vrai dire, ce film au-delà du médiocre n’a rien de remarquable hormis sa nullité. Sa nullité et sa misogynie. C’est le film le plus misogyne que j’aie jamais vu. Le plus misogyne de l’univers. Ophélie, mais on l’appelle O. parce que c’est plus stylé, celle qui nous raconte toute sa vie par le menu est le trophée bien carrossé de deux sales gosses. Ecervelée, défoncée, bien roulée, elle demande à ses « guys » de l’emmener dans un resto chic et fait chauffer la carte bleue au centre commercial, sa seule activité… Et comme dans toute histoire misogyne qui se respecte, c’est la fille qui fait perdre la raison au(x) garçon(s). A cause d’elle, ils se ruinent, perdent leur business, leurs principes et manquent mourir. Rien n’est trop beau ou trop fou ou trop dangereux pour ses yeux bleus et ses robes courtes.
Certains objecteront qu’il y a une forte femme dans ce film, Elena. Canon, dominatrice et sans cœur. Sauf que cette pauvre Salma Hayek doit incarner tous les clichés de la femme à poigne : racée, lookée, d’une cruauté sans fin. Mais elle se retrouve bien vulnérable dès qu’on touche à sa petite famille. Comble de la bêtise, quand elle découvre qu’on a enlevé sa fille, elle perd ses moyens, fond en larmes et enlève rageusement sa perruque de Cléopâtre pour nous faire voir ses petits cheveux piteux, sa fragilité, sa faiblesse : en fait, elle n’est même pas belle. Et d’ailleurs, celle qui se révèle être un vrai petit sucre d’orge dirige le cartel uniquement parce qu’elle a pris la relève de son mari, sans un homme, elle n’était rien.
Pour Oliver Stone, donc, les femmes sont forcement des mamans, ou des putains. Et c’est normal pour O., kidnappée, de tirer les larmes des yeux de sa geôlière en lui disant « I could be your daughter »…
On rirait bien, si ce n’était pas aussi tragique de voir un réalisateur devenir gâteux. On le sait, Oliver Stone est obsédé par l’Amérique. Obsédé par son histoire récente, obsédé par sa société contemporaine (JFK, Nixon mais aussi Wall Street ou le navrant World Trade Center…). Il y a presque vingt ans, Mickey and Mallory, le couple d’assassins tarés de Tueurs nés, portait la vision trash et tragique du réalisateur sur la société pourrie du spectacle, de l’entertainment et de la violence. Ils étaient cash, monstrueux et merveilleux. Ils étaient vrais.
Aujourd’hui, il choisit des petits jeunes fades et bronzés, une fille égérie de Chanel qu’il préfère mater qu’égratigner et deux garçons bodybuildés, plus cliché l’un que l’autre. Mais au lieu de critiquer un pays qui mutile ses enfants, hier au Vietnam, aujourd’hui en Irak, au lieu de critiquer la société du fric facile, il préfère raconter une histoire d’amour niaise qu’il croit sulfureuse parce qu’à trois et qui ne fait que confirmer la fin du soft power américain dans des vapeurs de weed et de superficialité.

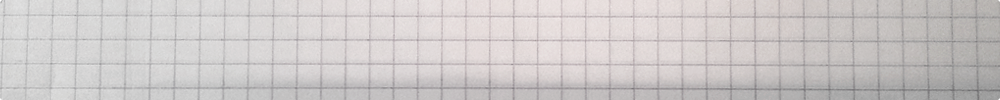

Laisser un commentaire