Poulailler urbain vertical
Une année, donc, a passé. On retrouve déjà l’odeur de ces journées où les filles en jupe patineuse, jambes nues, côtoient celles qui ont encore leur jeans coincé dans des bottes hivernales. Comme des plantes, comme des animaux, on refait surface. Visage tourné vers le soleil sur n’importe quel coin de terrasse.
Les petits métiers printaniers qu’on n’avait plus vus pendant des mois réapparaissent. Les jardiniers du jardin flottant, les ouvriers qui réalignent les pavés. Pour qu’on ne se coince pas un talon même bien éméché. Coups de karcher sur les bancs en bois. Et puis les joggeurs qui se sont multipliés depuis le passage à l’heure d’été. Ils marchent, sac à dos, pour aller au travail comme les enfants africains vont à l’école. Mais par plaisir et non par nécessité. Les agents de la propreté de Paris sont tous là. Il faut maintenant slalomer entre les camions poubelles et les hommes aspirateurs.
Les vestiges de la veille encombrent le passage et racontent une soirée parisienne. Pyramides de bouteilles de rosé, canettes écrasées, saucissons abandonnés. Ça résonne encore des rires alcoolisés. Des embrassades et des baisers. Des premiers rendez-vous fébriles. Des coups de foudre imaginés. Des numéros pas échangés.
Ça sent le rouge à lèvre légèrement filé sous l’effet de la chaleur.
Il ne faut pas beaucoup d’imagination pour se souvenir d’hier soir. Les corps entassés à la poursuite du moindre rayon de soleil. Les chaises longues qui se déplacent avec les heures. Les mains qui se frôlent. Les rapprochements.
Ça sent la séduction maladroite, les débuts de baston et l’urine. Ça sent beaucoup l’urine. Ça sent les cravates en polyester qu’on dénoue après deux bières. Les tops un peu trop transparents sur soutien-gorge noir. Ça sent les soirées entre filles pour critiquer les garçons en espérant secrètement se faire draguer par la bande de mecs en costumes à l’autre bout de la table collective. On parlera de sa journée de travail. Des heures qu’on aura passées sur booking pour préparer les vacances d’été. De machine qui est vraiment trop une conne. De où on ira dîner après. Du fait divers du jour, peut-être. Du dernier Snapchat qu’on a reçu.
Berges de Seine.
La route sent les pots d’échappement et le parfum vanillé des filles peu vêtues. Le bitume se dilate sous une chaleur trop forte, trop brutale. Éphémère. Et puis soudain cette odeur intenable. Ça sent l’usine, la catastrophe, la maladie. Les règles de sécurités pas respectées et les clandestins qui ne disent rien. Ca ne sent même pas le printemps. Ça sent la fin.

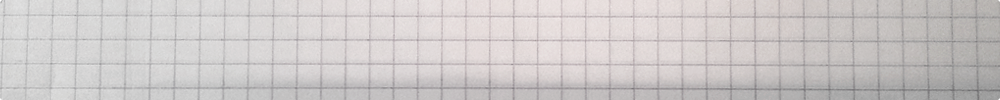

Laisser un commentaire