L’empire de la mythologie des signes (I)
Il est rutilant. Le zinc.
Cuivré je dirais. Et briqué comme pas possible. On se voit dedans. Je me fais un sourire dans le zinc pour vérifier que je n’ai pas un bout de patate coincé entre les dents. C’est ingénieux, y’a des petits crochets sous la rambarde pour suspendre un sac ou une veste. A ce zinc, on pourrait y rester des heures. D’ailleurs, je suspends mon sac au crochet et y reste des heures. Il est beau ce zinc, et on joue des coudes pour attraper son verre ou sa tasse, pour tourner la page d’un journal mal déplié.
Dans la rue étroite qui mène au zinc, le sol est humide devant une bouche d’aération, une grosse tache, vaporeuse. Et l’odeur. L’odeur de la lessive, de la laverie souterraine de l’hôtel. Peut-on vraiment s’accouder au zinc sans avoir senti cette odeur avant.
Au comptoir, on peut prendre un café. On peut, mais pas que. On peut aussi prendre une bière. On peut aussi prendre un kir à neuf heures du matin. Un sandwich. Un repas. On peut lire, discuter, donner ses rendez-vous, au comptoir. Au comptoir, on y vit.
Bonjour, de cette voix enfantine réservée aux serveurs. Est-ce que je pourrais avoir un café allongé avec une tartine ? Demandé, la main dans les cheveux, la tête un peu inclinée. En général ils disent que oui, on peut avoir un café allongé et une tartine.
Mais ce qui est fascinant au zinc, c’est quand même la concentration de destins qui s’y croisent. Hommes d’affaires, ouvriers, jeunes gens et piliers de bars se retrouvent, devant un café ou un ballon de rouge, accoudés, pour deux minutes ou la journée.
Certes, depuis peu, les bistros sont trustés par cette classe hégémonique et sur représentée que sont les trentenaires portant jean’s griffés, barbe incertaine, casque de scooter au creux du coude et iPhone alourdi de mille applications indispensables. Ils sont « DA », artistes, ou plus généralement « créa », et élisent domicile dans quelques troquets ciblés, faussement authentiques, anéantissant la diversité et renvoyant les habitants historiques des lieux dans une quête d’autres lieux, non encore souillés. Pourtant, peu de temps après, le créa se plaint que l’endroit a perdu son âme d’antan, jusque dans les pages du Figaro, médium prolétaire par excellence. Sauf qu’accoudé, au zinc, au comptoir, c’est Le Parisien qu’on lit et ses histoires d’enfant jeté par la fenêtre par son papounet, d’insécurité grandissante aux abords de la Gare du Nord, des travaux de voirie sur les boulevards des Maréchaux. Sauf qu’accoudé on ne finit jamais un article, trop déconcentré par les histoires du voisin, par les réflexions du barman, par les blagues incompréhensibles du serveur, par les gens qui passent le long de la vitre. Vraiment, on y vit bien au comptoir.

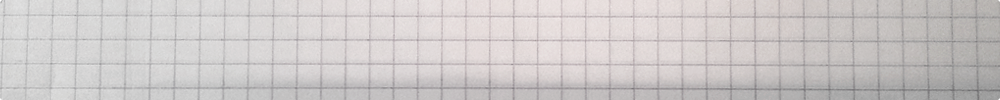

Laisser un commentaire