“J’ai une âme solitaire”
Comme des moutons dociles, le Lonely Planet à la main, dans toutes les langues du monde (occidental), nous traversons le pays. Le survolons. Le regardons. Comme des cons, nous consommons de l’image. Je prétends ne pas me reconnaître dans cette société, pas de grandes marques dans mon placard, pas d’intérêt pour les magazines féminins, pas d’accord avec la pression des agences de notation, pas de compromission avec le monde. Mais je suis bien pareille. Et moi aussi, je consomme de l’exotisme. Au prix fort. Car on ne consomme pas gratuitement de l’exotisme ou de l’image. Je paye ma carte UGC illimitée, pourquoi je ne paierais pas les pauvres que j’observe à satiété comme si j’étais au Ciné Cité des Halles ? D’ailleurs pour ce prix, on est bien en droit de s’affliger des fils électriques qui viennent gâcher nos parfaites photos d’un monde archaïque fantasmé. Comme le confort moderne abîme, s’empresse-t-on de twitter.
Le Lonely Planet porte bien son nom, au milieu de tous ces Français translatés depuis leur pavillon de banlieue jusque sur mon chemin du bout du monde, je me sens foutrement seule. Je les méprise. Tout ce qu’ils disent est stupide et vain. Mais c’est moi que je méprise. Car je suis stupide et vaine. Epingler une destination de plus à mon tableau de chasse. Dans dix ans, quand ce sera la destination hype, dire j’y étais, dire y’a dix ans c’était comme ci, comme ça, dire je connais. Alors que je ne connais pas, je ne connais rien. J’ai vu, mais je n’ai rien vu. Je n’ai rien compris. J’ai pris 3 000 photos mais mes yeux sont aveugles et mes clichés caduques.
J’ai contemplé les couleurs, j’ai dévisagé les passants, j’ai croqué les vues panoramiques. Mais je n’ai rien compris. J’ai accumulé des images, des endroits, des odeurs, des kilomètres dans la poussière, mais je n’ai rien vécu. Rien ressenti non plus. Je suis passée à travers. Les villes, les pays, les gens. A travers la vie.
Ici et ailleurs, le voyage. D’une charrette à boeufs pittoresque aux taxis jaunes emblématiques, c’est la même. La même boulimie d’images, de cadres, de plans, de photos que tout le monde prend en étant, paradoxalement, à la recherche de la photo jamais vue, de choses qu’on a déjà vues mille fois. Dans les guides, sur internet, dans des « beaux livres ». Je prends en photo ce que j’ai déjà vu en photo mais que je suis venue voir en vrai. Comme une preuve. J’étais là. Moi aussi. Comme tous les autres autour de moi. En occident, cet hiver il y aura des centaines, des milliers de photos, toutes pareilles, un peu floues, un peu brûlées par le soleil, qu’on essaiera désespérément de retravailler dans Photoshop ou qu’on montrera fièrement à ses amis sur son iPad.
Impression de suspension. Les jours défilent sans que le temps ne passe vraiment. Vertige des nuits qui s’enchaînent d’un bout à l’autre du pays. Ne jamais être chez soi et retrouver pourtant, partout, un petit savon rectangulaire fait à base de cadavres d’enfants, de l’eau dans de petites bouteilles en plastique, une prise électrique.
Dans le bus, trajet interminable. Je passe au chapitre suivant. Une ville, après une autre ville, après une autre ville. Ensuite, il y aura encore une ville. Et retour. Les must see des alentours que nous ne manquerons pas d’aller voir, et qui seront décevants, car moins beaux qu’en photo ou trop grands pour rentrer dans le cadre.
Sur la carte, les pays sont grisés. Vu. Vu. Vu. Visité. Fait. Comme on fait un caprice. Comme on fait une erreur. On fait une ville. On se fait un pays. On se fait des idées surtout. Une de plus. Un de plus. Mais ils ont tous le même goût d’essence et de graisse animale. Ils ont tous le même goût de cimetière. Et les comédies romantiques formatées qu’on avale pendant les douze heures d’avion n’y changent rien.
Escale à Bangkok, je me téléporte, ici, on est encore hier.

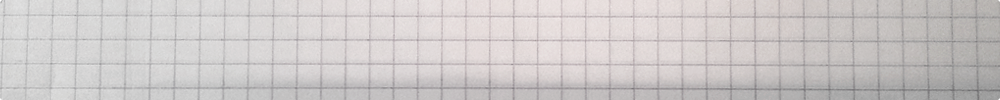

Laisser un commentaire