La vie ne m’apprend rien mais le vélo
Ca descend doucement, rien besoin de faire, juste regarder, serrer les poings de temps en temps, et regarder, un sourire béat sur les lèvres. Plus fort que moi. Plus fort que n’importe quel anxiolytique. Le vent presque chaud maintenant, le ciel clair qui devient rose, je me retourne pour mieux voir les nuages au dessus des quartiers chics, au loin, là-bas. Heureusement qu’il y a des nuages, sinon il n’y aurait pas de rose. J’ai un peu mal aux fesses. J’me plains pas. Un pignon fixe, svelte et sublime, me double.
Et comme à chaque fois qu’un pignon fixe me double, je me dis que je veux un vélo. Un vélo à moi. Un tout déglingué qui a sauvé des petits enfants pendant la guerre. Un high-tech avec les roues qui brillent la nuit. Un vélo de facteur d’avant les Kangoo avec un porte bagage immense à l’avant. Je fais tous mes trajets en Vélib’, moi. Et quand je peine dans la montée, je me prends à rêver d’un dix-huit vitesses à paillettes. Et puis j’arrive au sommet de la colline et j’ai déjà oublié. Déjà oublié parce que je n’aime rien de plus que le Vélib’. Avec cette révolution du moyen de transport en commun individuel, pas besoin d’être épaule contre épaule dans un wagon les jours de pluie ou de tenir une barre chauffée pendant des heures par des mains inconnues. Mais pas non plus besoin de posséder. J’adore savoir qu’ils sont tous là, par milliers, partout dans la ville, prêts à m’emmener n’importe où, sans correspondance ni incident voyageur. Ils ne sont pas à moi mais ils sont tous à moi. Perpétuelle première rencontre, premier trajet. Et il m’attend, à une station et je le dépose à une autre station et jamais on ne me le vole, mon Vélib’. Je le partage. Et je ne convoite pas. Sur un Vélib’, je me sens délicieusement communiste, et ceux qui pédalent à contre sens sur le trottoir en insultant les piétons, au goulag !
Un peu plus loin, un peu plus tard, je reprends un vélo. C’est déjà l’heure. L’heure de cette heure où tout est possible, l’heure de la certitude que quelque chose va se produire, ce soir. Cette heure comme un Magritte, où le ciel est encore bleu, presque phosphorescent alors qu’en bas, tout est déjà sombre, déjà un peu flou, même pour qui a de bons yeux. L’heure où tout est silencieux, même les voitures. L’heure finalement la plus sombre, avant de. Mais déjà, cette heure est passée, les lampadaires grésillent, rosissent puis s’allument et la ville prend un air de nuit, de mensonge. Et je glisse silencieusement sur le bitume orangé avec mon Vélib’ uniforme. Moi comme des milliers, au même instant. Uniques.

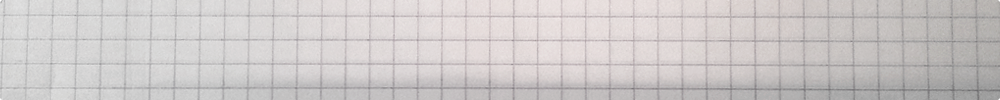

Laisser un commentaire