Relapse*
On s’est rencontré dans une soirée. On a discuté. Peut-être que tu es parti tôt. Peut-être qu’on est rentré ensemble. On. Je n’ai pas vu le temps passer. Tu parlais avec un copain. Ou tu parlais avec une fille plus jolie que moi. L’alcool aidant, la musique, la proximité, on a parlé. Peut-être que la fille plus jolie t’avait éconduit. En tout cas, on a commencé à discuter. Ou alors on ne s’est presque rien dit. Peut-être qu’on est parti ensemble en riant comme des enfants ou en s’embrassant dans l’ascenseur. Peut-être qu’il n’y avait pas d’ascenseur. Peut-être rien de tout ça. Il y a eu tellement de toi. Dans le couloir de cet appartement inconnu. Sur mon paillasson. Sous une musique assourdissante. Un gobelet en plastique à la main. A un feu rouge. Je t’ai donné mon numéro. Parfois, tu ne connaissais même pas mon prénom. Plusieurs fois en tout cas, avec plusieurs toi, il y a eu ce moment où debout l’un près de l’autre, le visage illuminé par ton Nokia, par ton iPhone, par ton Motorola Razr, tu as noté les dix chiffres que je te dictais. 06. Lentement. 32. La tête un peu penchée.
Et puis j’ai fermé la porte. Et puis je suis montée dans un taxi. Et puis tu as récupéré tes affaires. Et puis j’ai décroché un Vélib’. Et puis tu as pris ton scooter. Et puis je me suis recouchée. Et puis nous n’étions plus côte à côte. Je t’avais donné mon numéro et nous n’étions plus l’un à côté de l’autre. Il y a donc eu ce moment, une fois, mille fois, où je t’ai donné mon numéro avant que tu partes. Avant qu’on se sépare, même si nous n’avions partagé qu’un instant.
Ce moment unique, ce point de départ. Cette entrée dans une autre dimension. Dans l’attente angoissée. Fébrile. Avec ces chiffres échangés, 24, démarrait une nouvelle ère. Une nouvelle durée. Au commencement était le numéro. 45.
Je sais que tu ne m’appelleras pas. Pas encore. C’est trop tôt. Et le savoir me rassure. Je suis encore protégée, je peux rejouer à l’infini notre conversation, ta nudité, tes blagues pas vraiment drôles, mes techniques bien rodées. Et mon ventre se noue. Parfois. Mon ventre se replie quand je pense à toi. Et chaque fois que mon corps se souvient de toi, je me dis que tu n’appelleras pas. Mais c’est encore dimanche. Tu n’appelleras pas dimanche. Alors même si je me convaincs que tu n’appelleras pas, je peux encore y croire.
Tu n’appelles pas. J’attends. Je laisse le temps prendre le dessus. Me dominer. C’est cette attente qui te rend précieux. Et puis, plus personne n’appelle aujourd’hui. On envoie des SMS laconiques. J’attends ton SMS laconique. Tout en sachant que tu ne l’écriras pas. Et dans ce temps étiré, j’essaie en permanence de faire le deuil de ton appel. De ton message. De toi. En moi, se superposent la certitude que tu ne m’appelleras pas et l’envie que la vibration caractéristique me contredise.
Tu pourrais m’appeler.
Jour suivant. Tu ne m’appelles pas.
Je ne suis pas surprise. Je m’y prépare depuis le moment où je t’ai donné mon numéro. 78. Pourtant à chaque message, je veux que ce soit toi. Quand je prends mon téléphone, je me répète que ça ne peut pas être toi. Mais il faut que ce soit toi. Ce n’est jamais toi. Ni ce message, ni le suivant. Ni l’appel que je laisse aller directement sur mon répondeur. Je ne peux pas parler. Pas maintenant. Pas à quelqu’un d’autre que toi.
Pourtant, on ne se connaît pas. Mais c’est cette incertitude, qui te fait exister bien plus que le moment furtif que nous avons partagé. C’est cette angoisse qui te rend indispensable. Et plus je sais que tu n’appelleras pas, plus ton silence devient violent. Et plus j’ai besoin de toi dans ma vie. Aujourd’hui. Maintenant. Tout le temps.
A ce moment précis, le temps n’a plus de sens, plus de valeur. Chaque seconde sans ton appel devient une éternité inutile. Chaque jour sans ton appel passe beaucoup trop vite. Tu n’appelleras plus.
Et cette conviction porte en elle un nouveau souffle. Je ne suis plus dans l’attente. Je ne suis plus furieuse. Je suis préoccupée. Peut-être que tu as mal noté mon numéro. Peut-être que tu m’as écrit et que tu attends ma réponse. En vain. Je ne suis pas comme ça, tu sais. J’ai très envie de répondre à ce message que tu ne m’as pas envoyé. Mais. C’est mon téléphone qui ne marche pas. Je l’éteins. Je le rallume. Pas de message. J’appelle mon répondeur.
Vous n’avez aucun nouveau message.
J’envoie un SMS sans importance à une personne sans importance, parfois des SMS coincés dans les limbes de la bande passante arrivent d’un coup sur le téléphone. Rien n’arrive. Mon téléphone n’est pas cassé.
Tu ne m’appelles pas. Tu ne m’appelleras pas. Tu as bien raison de ne pas m’appeler.
Peut-être que tu aimerais bien m’appeler mais que tu ne peux pas. On t’a volé ton téléphone. Ou tu as trop de travail. Ou quelqu’un est mort. Ou tu es malade. Ou tu as eu un accident. Ou tu es mort. Peut-être que tu vas m’appeler. Ce soir. Ou peut-être que tu es mort.
Tu es mort. C’est la seule explication. Tant mieux.
Et si tu ne me rappelles jamais, le temps est comme suspendu. Encore aujourd’hui court ce temps, ce temps du vide. Quelque part. Sous toutes les couches, s’écrivent les lignes des garçons qui ne m’ont jamais rappelée. Des années plus tard, alors que j’ai oublié ton nom et connu d’autres garçons, l’attente est là, infinie et sourde. Inassouvie. Je te croise parfois dans le quartier, sans être tout à fait sûre que c’est toi. Et je me souviens que cette brèche est encore ouverte. Que j’attends toujours ton appel.
Ou tu appelles. Tu finis par m’écrire un message banal. Et à l’instant où ce numéro inconnu s’affiche, le monde est bouleversé. Ou seulement moi. Moi et mon ventre. Cet instant unique qui vient clore ces journées interminables. Obsessionnelles. Hors de toute réalité. Ces journées devenues des vies entières. Un infini insurmontable. Mon existence, encapsulée entre ces deux instants se contracte subitement.
Tu as fini par appeler. Le regret est plus fort que le soulagement. J’aurais préféré que tu n’appelles pas. Toute ma folie pour ce message. Tu m’ennuies un peu. Tu ne pouvais que me décevoir tant l’attente et l’excitation t’avaient magnifié. Remplacé même. Le drame qui s’est joué pendant ces quelques jours n’avait plus rien à voir avec toi. Je ne sais pas qui tu es.
Je relis ton message jusqu’à ce qu’il perde tout son sens. Jusqu’à ce que je ne comprenne plus ce que j’attendais. Ce que j’attendais de ces journées. Ce que j’attendais de toi. De ce temps dilaté, immense, meurtrier.
Finalement, ce n’était pas grand-chose. Presque rien.
* contribution à l’exposition Laps qui s’est tenue à la Fondation Vasarely du 11 mai au 7 juin 2014.

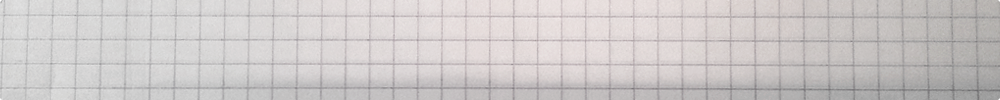

Laisser un commentaire